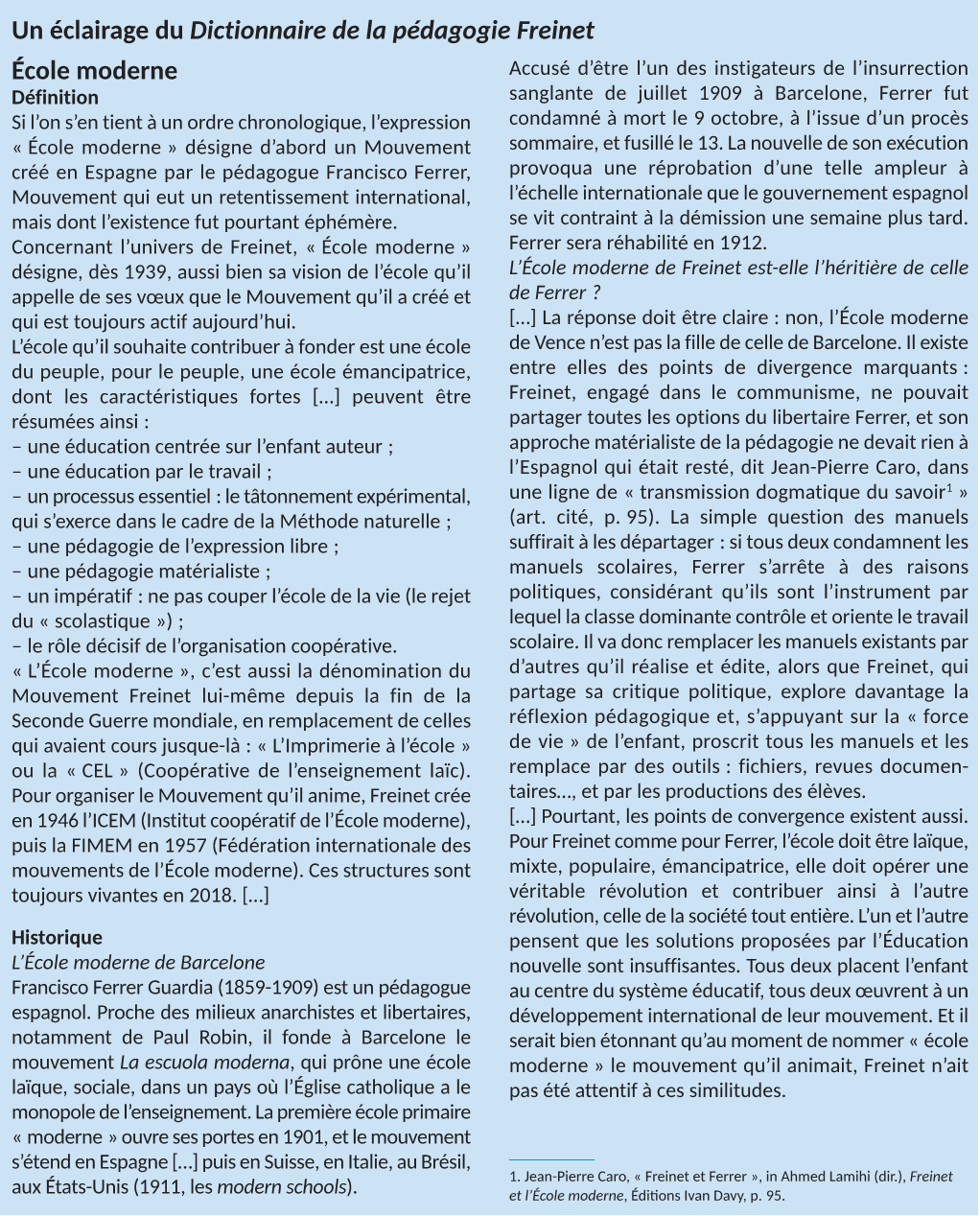Questionner le mot
« moderne »
Catherine Chabrun,
Véronique Decker, Xavier Fleury, Daniel Gostain, Damien
Tréton
Un débat de la liste ICEM.
Daniel
Gostain – « Je viens de visionner une
interview passionnante de Bruno Latour (https://www.
arte.tv/fr/videos/106738-001-A/entretiens-avec-bruno-latour-1/).
Il finit par "On ne se rendait pas compte à quel point la
notion de modernité fermait". Depuis longtemps, je trouve
que notre appellation "École moderne" ne va pas. En quoi la
modernité est-elle une vertu ? N’y aurait-il pas
d’autres qualificatifs qui conviendraient mieux à l’ICEM
que celui-ci ? Ne faudrait-il pas y
réfléchir ? »
Catherine
Chabrun – « C’était un choix de Freinet
qui se méfiait de l’appellation "Éducation nouvelle" et
préférait "École moderne", car pour lui "moderne" évitait
de figer les techniques pédagogiques comme le faisait
Montessori et leur permettait donc de se nourrir de la
société en continuelle évolution. »
Xavier
Fleury – « Très intéressante vidéo en
effet. Après son visionnage, je comprends pourquoi tu
questionnes cet adjectif, "moderne". Pour moi, ce mot parle
de l’émancipation de la tradition. C’est pourquoi j’y
entends quelque chose de positif.
Je n’y entends
pas les aspects évoqués par Latour, qui renvoient au
contexte historique dans lequel cette émancipation s’est
faite (l’époque des Lumières, il me semble) et qui donnent
des précisions sur la vision du monde qui en est résultée
(un monde fait d’objets qui n’ont pas de puissance d’agir
et où les sujets que nous sommes sont à distance de ces
objets). À mon avis, l’expression "École moderne" ne
concerne pas la question de la vision du monde, mais
spécifiquement l’évolution de l’École, en soulignant qu’il
s’agit de s’extraire de la tradition. C’est toujours
d’actualité que l’École s’extraie de la tradition, car s’il
y a bien eu émancipation des savoirs, la pédagogie, elle,
est encore empreinte de tradition. C’est pourquoi je trouve
que l’expression "École moderne" est une bonne boussole.
Cependant, ce n’est pas évident de séparer la question de
l’émancipation de la tradition et celle de la pertinence de
la vision du monde (monde régi par des lois
auxquelles la « Science » peut accéder ou monde habité
par des puissances d’agir de différentes natures – humains,
animaux, bactéries, virus, écosystèmes – avec leur
caractère imprévisible). Il me semble donc que cela vaut la
peine d’approfondir le questionnement sur ce
sujet. »
Véronique
Decker – « Lorsque Francisco Ferrer
prend l’adjectif "moderne", il désigne ce qui a été acté
par la science, par opposition à une école dans laquelle
les enfants copient, récitent des prières, apprennent la
vie des Saints et ne sont pas là pour comprendre le monde
qui les entoure. C’est cette modernité que va reprendre
Freinet. Appuyer les savoirs de l’école sur les
connaissances scientifiques actées du moment est essentiel,
face à un renouveau des charlatans, des guérisseurs, des
marabouts et rebouteux, des piétistes et des réactionnaires
religieux de toutes les religions. Le "moderne" ce
n’est pas le Formica vert des années 60, c’est
l’émancipation qui devient le but de l’école, alors que
tous les réactionnaires veulent en faire une école du
respect des puissants et de la soumission. »
Damien
Tréton – « Le questionnement dont se
fait le relai Bruno Latour dans cette série d’entretiens
(qui mérite effectivement d’être regardée) touche à notre
vision du monde. Pour réussir une révolution écologique, il
faut changer de paradigme, voilà ce que disent ces
philosophes (Latour n’est pas seul.) Transformer notre
lexique quotidien, réinterroger pour les réorienter nos
analyses scientifiques et humaines. Par exemple, comprendre
que le concept de lutte des classes a été fondé au
XIXe sur
l’acceptation de tous, que le monde serait construit autour
de la production. La révolution écologique invite à
repenser la lutte des classes autour de la mise en cause de
cette production. Qui produit ? Est-ce vraiment l’humain
qui produit du blé ?
On continue de
véhiculer l’idée que la vie s’est développée dans un
environnement terrestre exceptionnel. D’abord le milieu
favorable, ensuite le développement de la vie. Or, si les
conditions terrestres étaient effectivement
exceptionnellement favorables à l’émergence du vivant, les
résultats scientifiques d’aujourd’hui amènent à penser que
c’est ce vivant qui construit l’habitabilité de la Terre.
La vie engendre les conditions de la
vie.
Repenser
l’humain comme une espèce parmi les autres dont les
interactions favorisent ou défavorisent l’habitabilité du
monde pour telle ou telle espèce. La lutte des classes
pourrait se réorienter : « Qui modifie l’habitat ?
Comment ? Qui en profite ? Qui en souffre ? »
La Pédagogie Freinet
là-dedans ?
Comment penser l’éducation
à l’environnement, à l’histoire, à la géographie, aux
sciences, à la création en général, à la place de l’espèce
humaine dans le monde ? À l’organisation des humains dans
ce monde ? Autrement dit, l’étude du milieu n’est-elle pas
en train de devenir le cœur politique de l’éducation
aujourd’hui ?
Alors, Institut moderne ou
Méthode naturelle, notre problème, ce n’est pas de faire la
publicité de tel ou tel terme, mais de réfléchir sur des
pratiques de classe mises en perspective par ce
débat.