
Retour en enfance
Deborah
Gentès
Une redéfinition du statut de
l’enfant et de celui de l’adulte dans la relation
éducative, en pédagogie Freinet1.
1Célestin
Freinet développa une pédagogie, qu’il appellera pourtant
« moderne », de ce retour traumatique en enfance, à travers
son expérience de la Grande Guerre. Il en fera le récit
dans un petit livre, Touché !, souvenir d’un blessé de
guerre, dans lequel
il décrit sa convalescence. Il raconte comment il doit
réapprendre chaque geste de la vie quotidienne et refaire
si péniblement le chemin des apprentissages, qui sont pour
l’enfant, le découvrira-t-il alors, « naturels » : « Je
commence à faire quelques pas en m’accrochant partout. J’ai
même traversé la ruelle sans me tenir et me suis précipité
sur le lit comme un enfant mal assuré se jette dans les
bras de sa maman. Je suis allé de mon lit jusqu’à la
fenêtre. J’ai été fier de mon œuvre…2 »
[…]
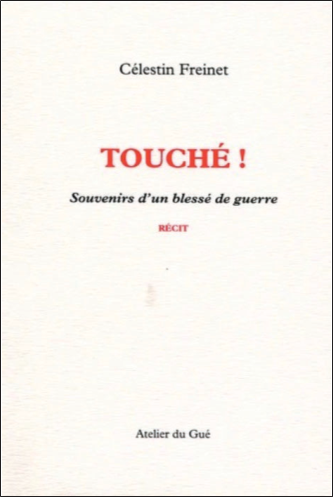
Il termine sur la perte
définitive de sa jeunesse et de son insouciance. Il a fait
l’expérience conscientisée du retour à un état d’enfant
dépendant, mais apprenant et de la perte définitive de son
enfance dans cette épreuve. De cette prise de conscience,
il développera une pédagogie qui fera le lien entre la
remise en question du statut de l’enfant dans la société
adulte et l’espoir de l’émancipation du peuple.
Lorsqu’il veut
reprendre son métier d’instituteur, alors qu’il a été
grièvement blessé au poumon, Célestin Freinet a du mal à
parler, et il en fera un invariant de sa pédagogie, qui en
comporte trente : « Parlez le moins possible ». Il est
aussi très affaibli, il doit rester la plupart du temps
assis. Son corps ne peut plus se tenir debout sur l’estrade
au-dessus des élèves assis à leur pupitre, ni sa voix
porter sur l’ensemble de la classe. Dans ce face-à-face
entre le corps défaillant de l’instituteur et celui de ses
élèves, une inversion à la norme éducative et
institutionnelle émerge : ce sont les corps des élèves qui
vont suppléer au manquement du corps de leur
instituteur. Ils ne vont plus être rivés à
leur place d’élève ni d’enfant, ils vont se déplacer,
pour travailler en atelier et construire leurs
connaissances par le « tâtonnement expérimental », dans la
« coopération ». Dans ce même rapport à la praxis,
l’enseignant sortira les élèves de la classe et de l’école,
pour les confronter à la réalité du monde du travail et de
la nature : « Mais alors, le maitre ne sera plus
omnipotent ? Il faudra qu’il subisse les observations et
les remontrances de ses élèves, s’il les a méritées. Il
faudra qu’il apprenne à les regarder, non avec ses yeux
d’homme, mais avec des yeux d’enfant ; et qu’il ne soit
parmi eux tous que l’enfant le meilleur qui s’impose comme
exemple et comme guide dans la république nouvelle. Et il
nous faudra lutter longtemps avec nous-mêmes pour arriver à
cela.3 » […]
L’expérience vécue par
Freinet, à la fois dans sa radicalité incarnée de blessé de
guerre et dans sa dimension universaliste de militant du
socialisme, lui a ouvert la voie vers un renversement des
positions de pouvoirs entre les enfants et les adultes. Il
en fera cet autre invariant de sa pédagogie : « L’enfant
est de même nature que nous ». Car l’efficacité4 de la
pédagogie Freinet réside dans cette pratique, qui permet
d’expérimenter à travers les différents espaces de
médiation au savoir, à la fois par l’enseignant et par les
élèves, ce renversement de positionnement entre ceux qui
savent, les adultes, et ceux qui apprennent,
les enfants.
Dans ce sens, je dirais qu’entrer en pédagogie différente
c’est « également », accepter d’entrer en ignorance.
Jacques Rancière,
philosophe, renverse cette définition de nature de la
pédagogie, qui institue l’avance prise par les adultes sur
l’enfant par l’accumulation des expériences dans ce rapport
au savoir. Entre les discours éclairés des adultes et
l’inculture de l’élève, il défend « une égalité des
intelligences » dans la posture ignorante du
maitre5.
Célestin Freinet était en
rupture avec les institutions académiques : il s’opposait à
ce qu’il nommait « les savants », responsables, d’après
lui, par la reproduction des élites, d’une inégalité
intrinsèque à la société, mais plus encore, par la forme
qu’ils ont instituée d’une diffusion des savoirs qui va du
haut vers le bas. Cette transmission verticale assèche et
capture toute capacité de production intellectuelle des
enfants comme des adultes issus des classes sociales
inférieures, à partir de leur propre expérience du monde.
Alors institués dans leur statut d’ignorant, ils le
deviennent aussi d’eux-mêmes.

Le titre que j’ai donné à
l’article (paru dans la revue SpécifiCITés) provient d’un texte d’Élise Freinet,
diffusé par une militante de l’ICEM, sur une liste de
discussion du mouvement Freinet, pour revivifier un débat
qui n’est jamais clos en pédagogie, sur la relation entre
le statut de l’enfant et celui du savoir. Dans la rubrique
« La part du maitre – La part de l’enfant » de la
revue L’Éducateur, en 1953, Élise Freinet engageait ses
« camarades » à inverser cette proposition, du
maitre d’abord
et de l’enfant ensuite : « Nous avions, au
début de l’année, tenté de
donner un aspect nouveau à cette rubrique, en renversant,
pour ainsi dire, le sens des valeurs : “La part de l’enfant
dans l’éducation du maitre”. Car il ne fait pas de doute
que c’est en contact avec l’enfant, que c’est dans nos
présences à ses actes de vie, que nous nous découvrons
nous-mêmes, que nous nous formons, que nous nous
éduquons.6 »
martin.gentes@wanadoo.fr

1Ce texte
est extrait d’un article de l’autrice : « L’entrée en
pédagogie différente : la part de l’enfant dans l’éducation
du maitre », p. 216 à 218, in SpécifiCITés,
Vol. 2018/2, no 12.
4En
référence aux travaux de l’équipe Théodile de
Lille III, dirigés par Yves Reuter à l’école Freinet
de Mons-en-Baroeul.
6Élise
Freinet, « La part de l’enfant dans l’éducation du
maitre », in L’Éducateur (14-15),
avril-mai 1953.