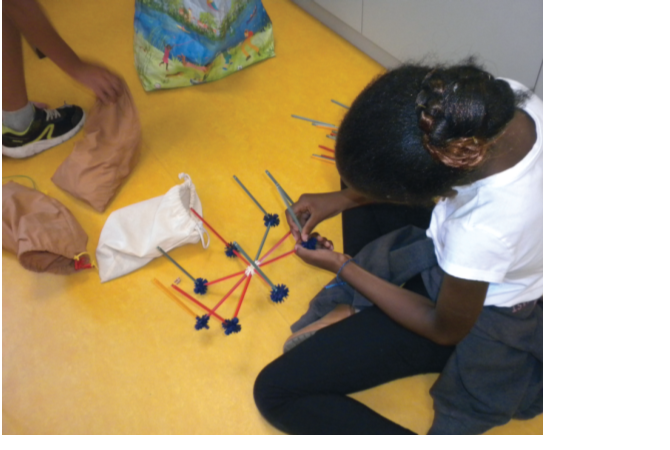Pour construire un monde
plus juste
Véronique
Decker
Des préalables pour démarrer en
pédagogie Freinet.
Est-ce qu’on entre « dans
la pédagogie Freinet » comme on entrerait dans un château,
en passant le pont-levis et en franchissant
des douves verdâtres ?
Est-ce qu’on démarre comme on ferait démarrer une voiture
de course toujours susceptible de nous échapper au premier
virage ?
La pédagogie
Freinet, avant d’être des techniques pour la réaliser,
c’est d’abord un état d’esprit, une vision politique d’un monde
plus juste, permettant à chacune et chacun de s’exprimer
par une vie active, créative, et coopérative.
Et donc, pour une vie
entière d’enseignant, d’enseignante, ce
sont des recherches, que nous faisons ensemble, avec nos
propres élèves. Car en premier, nous ne sommes
plus « face aux élèves », nous sommes à leurs côtés.
Nous marchons avec eux sur des sentiers de réflexion, sur
des chemins d’apprentissage, et nous allons rechercher ceux
qui sont restés emberlificotés dans les ronces.
Parce que j’ai été
directrice d’école, déchargée de classe une bonne part de
ma carrière, je me régale à la retraite de
faire des ateliers avec les élèves. Du bénévolat,
dans des écoles
volontaires, mais aussi des ateliers hors temps
scolaire.
Alors, qu’est-ce que je
mets en deuxième dans la
pédagogie Freinet ? La possibilité
d’observer les
élèves et de regarder attentivement leurs procédures. Les
voilà lancés dans leurs recherches, et le tâtonnement
expérimental fait jaillir quelques trouvailles.
J’observe les
procédures de
construction et j’interviens pour donner les mots dont ils
ont besoin pour parler de leur création, en disposant du
vocabulaire pour décrire les actes et les émotions qui les
portent, échanger avec leurs camarades, et réfléchir plus
collectivement.

En troisième, je mettrai
l’attention aux enfants des milieux populaires : ceux qui
expérimentent moins avec leurs parents, qui
sont parfois fatigués, parfois mal logés, parfois un peu
des deux. Alors, ils ne jardinent pas, ils ne bricolent
pas, ils ne cuisinent pas. Ces enfants-là doivent
expérimenter le monde pour en comprendre les
épures
mathématiques, les allégories littéraires. Donc, projets de
sorties dans la nature, de construction de cabanes, de
classes transplantées, sable, eau, terre, feu, air.
En quatrième, tout ce qui
ne « sert à rien », l’art, la musique, la peinture, ce qui
est juste là pour que s’expriment nos émotions, nos désirs,
et notre joie.
Mais rien de tout cela n’a
de sens si nous ne le faisons pas ensemble, tous ensemble,
sans abandonner qui que ce soit au détour d’un chemin.
Notre vision d’un monde plus juste n’est pas
réservée à
ceux et celles qui peuvent payer une école alternative. Nous
savons que la planète est au bord de l’asphyxie, et
qu’aucun enfant ne « s’en sortira » seul. Seules les
valeurs de la
coopération permettront aux enfants de former une
génération d’adultes capables d’agir efficacement.
Alors, ma petite pierre,
c’est de faire des ateliers de construction. Pour
construire symboliquement le monde de demain. Pour que
les filles
(auxquelles on n’achète jamais de jeux de construction)
construisent aussi.
Pour que tous apprennent les maths non pas comme une matière sèche
et aride, mais comme un langage dont les
segments, les
sommets, les axes, les dimensions sur le plan et dans
l’espace prennent sens.
Ils sont alors les
Égyptiens qui construisent des pyramides, des bâtisseurs
de cathédrales, des forains de manèges
articulés, des astronomes qui
décrivent les
systèmes solaires.
Tous ces solides font
réfléchir à la solidarité nécessaire pour les bâtir. Même
en modèles réduits. Ils jouent ? Non, ils travaillent à
représenter le monde avec leurs mains d’enfants.
v.decker@laposte.net